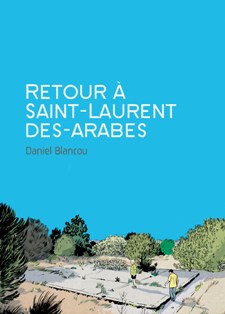 A l’heure du cinquantenaire des accords d’Evian et de l’indépendance de l’Algérie, Daniel Blancou mène l’enquête à travers le témoignage de ses parents, sur l’intégration des Harkis en Francez dans les années 1960-1970. Un récit juste et touchant. Rencontre avec l’auteur.
A l’heure du cinquantenaire des accords d’Evian et de l’indépendance de l’Algérie, Daniel Blancou mène l’enquête à travers le témoignage de ses parents, sur l’intégration des Harkis en Francez dans les années 1960-1970. Un récit juste et touchant. Rencontre avec l’auteur.
Prison ? Camp ? Comment définir Saint-Maurice-l’Ardoise ?
De nombreux résidents l’appelaient « la réserve » d’Indiens, et le terme me semble plutôt juste. Une réserve, c’est plutôt plus insidieux qu’une prison. On y case des gens censés rester libres de leurs mouvements, sauf que cette liberté ne s’applique qu’à un espace fortement délimité... Comme les Indiens, les Harkis ont été parqués dans une réserve. Un petit bout de campagne dans le Gard, où on les a oubliés. Ils y vivaient en communauté, coupés du monde, dans une illusion de vie normale, mais restaient toujours entourés de barbelés, de gardiens, et de règles de vie très strictes. Les autorités françaises leur imposaient, par exemple, tous les soirs, un couvre-feu en coupant l’électricité dans les maisons.
Comment est arrivée l’envie de vous emparer de ce sujet ?
Les Harkis constituent un débat d’Histoire et de société important. Mais je n’entendais à leur sujet que le point de vue de leurs enfants, ou alors d’historiens. Mes parents, longtemps enseignants à Saint-Maurice-l’Ardoise, et très impliqués dans leur mission culturelle et sociale d’éducation, avaient des Harkis une vision qui me semblait complémentaire, inattendue et intéressante. J’ai donc décidé de leur donner la parole.
Comment ont-ils accueilli le projet ?
Je le leur ai annoncé au cours d’un repas de famille. Ils n’ont pas tout de suite mesuré à quel point j’allais creuser le sujet ! Nous avons toujours parlé du camp, sans aucun tabou. Mais il m’a fallu leur poser de très nombreuses questions, parler avec eux des heures durant, afin de cerner au plus juste leur ressenti et d’éclairer les zones d’ombre. Je voulais découvrir comment ils étaient arrivés à Saint-Maurice-l’Ardoise. Mais surtout comprendre pourquoi ils avaient souhaité y rester. Leur manque flagrant de formation face à des enfants ne parlant pas le français, mais aussi la violence de certains adultes désireux d’attirer l’opinion publique sur leurs conditions de vie déplorables, auraient pu les inciter au départ.
Votre ton, votre dessin, rappellent celui d’un certain Emmanuel Guibert...
Merci. J’avais envie pour cet album d’un dessin sobre, très neutre, qui permettrait au lecteur de se centrer sur le propos, et rien que sur le propos. « La Guerre d’Alan » dont j’ai emprunté le découpage en gaufrier, a bien sûr fait partie de mes livres de chevet. J’ai même appelé Emmanuel Guibert, afin de lui demander des conseils. Il m’a encouragé à prendre tout mon temps pour consigner les témoignages de mes parents et des Harkis. Car plus on attend pour dessiner, m’a-t-il dit, plus on est impatient de le faire. Il avait raison.
Francescu Maria Antona
