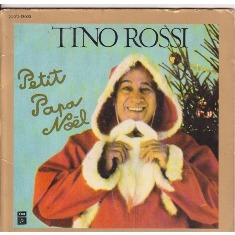 Jours de Noël et du Nouvel An. Propices à la flânerie. Elle entraînera cette réflexion sur la culture orale et populaire de la Corse. Trois petits faits sont à l’origine de ce thème. Le « Papa Noël » de l’illustre crooner ajaccien. Son hymne vient d’exercer sa royauté absolue à travers toutes les langues, sur la planète entière. Le rappel des cantiques et berceuses traditionnels du « Bambinu » de notre île. La publication d’un ouvrage complet sur la chorale bastiaise des « Macchiaghjoli » avec ses succès sur les scènes prestigieuses d’Europe. Enfin, quatrième événement modeste mais déclencheur de cette perception des choses, la communication d’un extrait du JDC daté du 6 mai 1840, débusqué de l’oubli. Une souscription y est lancée pour venir en aide à un jeune pâtre de la Restonica, pourvu d’un don poétique tout en étant analphabète. De nombreux notables ajacciens ont répondu à ce premier appel pour lui donner l’instruction nécessaire à l’épanouissement de son talent. L’apprentissage se fera par la connaissance de la langue italienne. Ce cénacle ajaccien de lettrés et de notables pense comme Salvator Viale, grand poète insulaire, que » les Corses n’ont et certainement ne peuvent avoir autre poésie et littérature que l’italienne. » Cette position est significative du discrédit public dans laquelle était tenue la culture orale du « basso popolo » et de « l’idiome grossier (rozzo) des montagnards encore à cette époque. Et ceci malgré l’accueil favorable qu’avaient trouvé dans le public européen, depuis quelque temps, les poèmes attribués à l’antique barde celtique Ossian, oralement conservés par les Ecossais depuis des temps immémoriaux. La voie était ouverte par les Britanniques et principalement Walter Scott, le « Napoléon du roman ». Celui-ci, comme le reste de l’Europe, s’intéressait aux origines de Napoléon. Il publia une Vie de Napoléon en 1827. Il s’était beaucoup servi pour sa documentation des « Sketches of Corsica » de Benson, journal de voyage résultant du séjour en Corse de l’auteur en 1823. Publié en 1825, l’ouvrage relatait les us et coutumes ancestraux des Corses, sans les travestir. En cette même année 1840, le branle définitif va être donné par deux écrivains renommés en Europe. Publication à Paris de « Colomba » de Prosper Mérimée. Edition à Venise des « Canti popolari toscani, corsi, illirici e greci de NicoloTomaseo. Avec ces deux littérateurs la poésie et les chants populaires corses ont passé la mer vers le Continent. Mérimée a pu être parfois malmené par l’opinion publique corse. Mais la jeune voceratrice Colomba et sa complainte funèbre sont entrées dans la littérature. La femme corse est devenue un être poétique et admirée comme telle, emblématique de la Corse. Dés le 26 août 1840 on peut lire cette appréciation du Journal de la Corse :»Ce petit roman est, sans contredit, ce qui a été écrit de plus parfait et de plus exact sur la Corse. » Après cette dernière date repère du milieu du siècle, la culture ancestrale, orale, populaire, poétique, artistique et linguistique des Corses va être sauvegardée, honorée et promue. Poésie étroitement liée aux chants, ceux de la foi, de la mort, de la guerre, du travail, de l’amour, de la douleur et de la joie : la liste est très longue de tous les mainteneurs qui dans les domaines des arts, des lettres, ou des sciences ont œuvré à les conserver, les mettre en valeur et en faire la diffusion. Un hommage spécial est mérité par tous ces artistes qui, de manière ininterrompue ont fait vivre ce culte culturel dans la population de l’île et de tant d’autres pays. On rejoint ici la Nanna du Bambinu, Tino Rossi et les Macchjaghjoli. A travers eux ce sont tous les chanteurs d’Opéra ou de charme, ceux des groupes dits « folkloriques » avec leurs artistes et leurs animateurs et animatrices qu’il faut remercier et honorer. Ils ont été les gardiens du Temple. Le chœur « A Cirnea » avec Félix Quilici, « A Paghjella » avec Isabelle Casanova, « A Manella » de Jacques Luciani, comme les « Macchjaghjoli » de Joséphine Poggi. N’oublions pas non plus Henri Tomasi et ses opéras nourris par les mélodies et danses populaires. Les grands ténors du répertoire : José Lucioni, César Vezzani, Gaston Micheletti, la soprano Martha Angelici, notre diva, le tenorino ajaccien Tino Rossi, Charles Rocchi etc… On ne peut nommer ici tous les chanteurs, cantatrices, musiciens, compositeurs, orchestres, critiques, écrivains, qui ont entretenu cette flamme. Ils commencent aujourd’hui à sortir de l’ombre et de l’ingratitude où les a tenus pour la plupart ce mot de réappropriation de la culture corse (riacquistu). Ce mot est inapproprié. Il signifie que tout ou partie de cette culture aurait été perdu, volé ou occulté. Il n’en est évidement rien. Tout a été préservé et auréolé par ces gardiens du Temple. Grâces leur soient rendues en les remettant à la première et juste place.
Jours de Noël et du Nouvel An. Propices à la flânerie. Elle entraînera cette réflexion sur la culture orale et populaire de la Corse. Trois petits faits sont à l’origine de ce thème. Le « Papa Noël » de l’illustre crooner ajaccien. Son hymne vient d’exercer sa royauté absolue à travers toutes les langues, sur la planète entière. Le rappel des cantiques et berceuses traditionnels du « Bambinu » de notre île. La publication d’un ouvrage complet sur la chorale bastiaise des « Macchiaghjoli » avec ses succès sur les scènes prestigieuses d’Europe. Enfin, quatrième événement modeste mais déclencheur de cette perception des choses, la communication d’un extrait du JDC daté du 6 mai 1840, débusqué de l’oubli. Une souscription y est lancée pour venir en aide à un jeune pâtre de la Restonica, pourvu d’un don poétique tout en étant analphabète. De nombreux notables ajacciens ont répondu à ce premier appel pour lui donner l’instruction nécessaire à l’épanouissement de son talent. L’apprentissage se fera par la connaissance de la langue italienne. Ce cénacle ajaccien de lettrés et de notables pense comme Salvator Viale, grand poète insulaire, que » les Corses n’ont et certainement ne peuvent avoir autre poésie et littérature que l’italienne. » Cette position est significative du discrédit public dans laquelle était tenue la culture orale du « basso popolo » et de « l’idiome grossier (rozzo) des montagnards encore à cette époque. Et ceci malgré l’accueil favorable qu’avaient trouvé dans le public européen, depuis quelque temps, les poèmes attribués à l’antique barde celtique Ossian, oralement conservés par les Ecossais depuis des temps immémoriaux. La voie était ouverte par les Britanniques et principalement Walter Scott, le « Napoléon du roman ». Celui-ci, comme le reste de l’Europe, s’intéressait aux origines de Napoléon. Il publia une Vie de Napoléon en 1827. Il s’était beaucoup servi pour sa documentation des « Sketches of Corsica » de Benson, journal de voyage résultant du séjour en Corse de l’auteur en 1823. Publié en 1825, l’ouvrage relatait les us et coutumes ancestraux des Corses, sans les travestir. En cette même année 1840, le branle définitif va être donné par deux écrivains renommés en Europe. Publication à Paris de « Colomba » de Prosper Mérimée. Edition à Venise des « Canti popolari toscani, corsi, illirici e greci de NicoloTomaseo. Avec ces deux littérateurs la poésie et les chants populaires corses ont passé la mer vers le Continent. Mérimée a pu être parfois malmené par l’opinion publique corse. Mais la jeune voceratrice Colomba et sa complainte funèbre sont entrées dans la littérature. La femme corse est devenue un être poétique et admirée comme telle, emblématique de la Corse. Dés le 26 août 1840 on peut lire cette appréciation du Journal de la Corse :»Ce petit roman est, sans contredit, ce qui a été écrit de plus parfait et de plus exact sur la Corse. » Après cette dernière date repère du milieu du siècle, la culture ancestrale, orale, populaire, poétique, artistique et linguistique des Corses va être sauvegardée, honorée et promue. Poésie étroitement liée aux chants, ceux de la foi, de la mort, de la guerre, du travail, de l’amour, de la douleur et de la joie : la liste est très longue de tous les mainteneurs qui dans les domaines des arts, des lettres, ou des sciences ont œuvré à les conserver, les mettre en valeur et en faire la diffusion. Un hommage spécial est mérité par tous ces artistes qui, de manière ininterrompue ont fait vivre ce culte culturel dans la population de l’île et de tant d’autres pays. On rejoint ici la Nanna du Bambinu, Tino Rossi et les Macchjaghjoli. A travers eux ce sont tous les chanteurs d’Opéra ou de charme, ceux des groupes dits « folkloriques » avec leurs artistes et leurs animateurs et animatrices qu’il faut remercier et honorer. Ils ont été les gardiens du Temple. Le chœur « A Cirnea » avec Félix Quilici, « A Paghjella » avec Isabelle Casanova, « A Manella » de Jacques Luciani, comme les « Macchjaghjoli » de Joséphine Poggi. N’oublions pas non plus Henri Tomasi et ses opéras nourris par les mélodies et danses populaires. Les grands ténors du répertoire : José Lucioni, César Vezzani, Gaston Micheletti, la soprano Martha Angelici, notre diva, le tenorino ajaccien Tino Rossi, Charles Rocchi etc… On ne peut nommer ici tous les chanteurs, cantatrices, musiciens, compositeurs, orchestres, critiques, écrivains, qui ont entretenu cette flamme. Ils commencent aujourd’hui à sortir de l’ombre et de l’ingratitude où les a tenus pour la plupart ce mot de réappropriation de la culture corse (riacquistu). Ce mot est inapproprié. Il signifie que tout ou partie de cette culture aurait été perdu, volé ou occulté. Il n’en est évidement rien. Tout a été préservé et auréolé par ces gardiens du Temple. Grâces leur soient rendues en les remettant à la première et juste place.
Marc’Aureliu Pietrasanta
