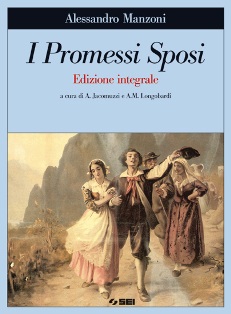 Fin de l’été et rentrée scolaire. Notre attention a été retenue par la lecture du dernier numéro du JDC. Deux articles particulièrement intéressants. La mercuriale d’une pertinente journaliste et la réflexion éditoriale. Toutes deux, à leur manière, sur l’état et l’avenir des parlers corses. Alexandra Sereni s’adresse à nous tous qui passons notre temps à dire en français combien nous voulons sauver notre langue. Elle n’hésite pas à manifester l’irritation qu’elle éprouve envers certains « pédants horripilants qui font le plein de vide autour d’eux, quand ils s’expriment dans une des « lingue nustrali » qui n’appartiennent qu’à eux et aux labos de langue. » Certes, certes… il est vrai que ce « sabir prétentieux », auquel elle s’attaque, envahit nos ondes, nos journaux et nos livres, éloignant du corse tous ceux qui simples lecteurs ou auditeurs, ne sommes peut-être pas assez préparés à déchiffrer les logogriphes de tous ces néologismes, et qui trouvent ces propos ennuyeux. Peut-il en être autrement ? Nous sommes pris entre l’enclume et le marteau. D’un côté un jargon populaire désormais trempé de gallicismes et d’italianismes innombrables. De l’autre, le purisme de quelques linguistes traditionnels ou bien les innovations peu attrayantes des évolutionnistes du néo corse. Déjà l’orthographe des parlers corses, trop éloignée des sons était suffisamment compliquée et par là rebutante pour des gens issus de l’oralité. Mais aujourd’hui c’est la prononciation elle-même qui se délite et s’éloigne du phonisme même des langages corses des générations précédentes. De la sorte semble bien se vérifier le constat de cet éditorial approfondi du même numéro du JDC. Il s’agit de l’identification de plus en plus signalée des Corses et de leur expression culturelle à la culture française : « la langue corse dont on saluait naguère l’authenticité ne semble retrouver une certaine vigueur que dans le calque français » nous dit notre éditorialiste. Il s’agit des structures mêmes de la phrase, de la syntaxe et des tournures expressives. Une sorte de patois invraisemblable tend alors à s’implanter. Faut-il voir un indice supplémentaire de ce calque ou de ce prisme dans l’idée de la Collectivité de Corse inscrivant à son programme de trancher de l’officialité d’une langue ? N’est-ce pas là la transposition même de l’ordonnance de Villers-Cotterets de François Premier par de bons élèves de l’Histoire de France ? On sait que le roi imposa le dialecte de l’Ile de France, comme unique langue reconnue par le pouvoir politique, au reste du pays. La Corse possède un très riche patrimoine représenté par une vingtaine de dialectes. Ceux-ci forment deux grandes entités linguistiques, la méridionale et la septentrionale, séparées par une ligne qui s’étend de l’embouchure de la Liscia, au nord d’Ajaccio, à l’embouchure du Fiumorbu sur la côte orientale. Chacune de ces langues a son vocabulaire, sa grammaire, ses dictionnaires, sa littérature et ses auteurs. L’unité de la Corse était formée par ses mœurs. Le choix de l’officialité de l’une de ces deux langues sonnerait le glas de la disparition de l’autre. Inéluctablement, cette mesure serait discriminatoire à l’encontre de la partie lésée, celle du Nord ou celle du Sud. Lorsque l’Etat italien se créa aux dix neuvième siècle, pareille question fut résolue de toute autre manière. Le toscan était déjà, depuis des siècles le dialecte de Dante, de Pétrarque et de Boccace. Mais surtout Manzoni et ses « Promessi Sposi » contribuèrent à cette reconnaissance par toute l’Italie et à l’agrégation des autres dialectes. Ainsi naquit la langue Italienne, non par le glaive du politique mais par la plume du talent. Nous sommes loin du compte.
Fin de l’été et rentrée scolaire. Notre attention a été retenue par la lecture du dernier numéro du JDC. Deux articles particulièrement intéressants. La mercuriale d’une pertinente journaliste et la réflexion éditoriale. Toutes deux, à leur manière, sur l’état et l’avenir des parlers corses. Alexandra Sereni s’adresse à nous tous qui passons notre temps à dire en français combien nous voulons sauver notre langue. Elle n’hésite pas à manifester l’irritation qu’elle éprouve envers certains « pédants horripilants qui font le plein de vide autour d’eux, quand ils s’expriment dans une des « lingue nustrali » qui n’appartiennent qu’à eux et aux labos de langue. » Certes, certes… il est vrai que ce « sabir prétentieux », auquel elle s’attaque, envahit nos ondes, nos journaux et nos livres, éloignant du corse tous ceux qui simples lecteurs ou auditeurs, ne sommes peut-être pas assez préparés à déchiffrer les logogriphes de tous ces néologismes, et qui trouvent ces propos ennuyeux. Peut-il en être autrement ? Nous sommes pris entre l’enclume et le marteau. D’un côté un jargon populaire désormais trempé de gallicismes et d’italianismes innombrables. De l’autre, le purisme de quelques linguistes traditionnels ou bien les innovations peu attrayantes des évolutionnistes du néo corse. Déjà l’orthographe des parlers corses, trop éloignée des sons était suffisamment compliquée et par là rebutante pour des gens issus de l’oralité. Mais aujourd’hui c’est la prononciation elle-même qui se délite et s’éloigne du phonisme même des langages corses des générations précédentes. De la sorte semble bien se vérifier le constat de cet éditorial approfondi du même numéro du JDC. Il s’agit de l’identification de plus en plus signalée des Corses et de leur expression culturelle à la culture française : « la langue corse dont on saluait naguère l’authenticité ne semble retrouver une certaine vigueur que dans le calque français » nous dit notre éditorialiste. Il s’agit des structures mêmes de la phrase, de la syntaxe et des tournures expressives. Une sorte de patois invraisemblable tend alors à s’implanter. Faut-il voir un indice supplémentaire de ce calque ou de ce prisme dans l’idée de la Collectivité de Corse inscrivant à son programme de trancher de l’officialité d’une langue ? N’est-ce pas là la transposition même de l’ordonnance de Villers-Cotterets de François Premier par de bons élèves de l’Histoire de France ? On sait que le roi imposa le dialecte de l’Ile de France, comme unique langue reconnue par le pouvoir politique, au reste du pays. La Corse possède un très riche patrimoine représenté par une vingtaine de dialectes. Ceux-ci forment deux grandes entités linguistiques, la méridionale et la septentrionale, séparées par une ligne qui s’étend de l’embouchure de la Liscia, au nord d’Ajaccio, à l’embouchure du Fiumorbu sur la côte orientale. Chacune de ces langues a son vocabulaire, sa grammaire, ses dictionnaires, sa littérature et ses auteurs. L’unité de la Corse était formée par ses mœurs. Le choix de l’officialité de l’une de ces deux langues sonnerait le glas de la disparition de l’autre. Inéluctablement, cette mesure serait discriminatoire à l’encontre de la partie lésée, celle du Nord ou celle du Sud. Lorsque l’Etat italien se créa aux dix neuvième siècle, pareille question fut résolue de toute autre manière. Le toscan était déjà, depuis des siècles le dialecte de Dante, de Pétrarque et de Boccace. Mais surtout Manzoni et ses « Promessi Sposi » contribuèrent à cette reconnaissance par toute l’Italie et à l’agrégation des autres dialectes. Ainsi naquit la langue Italienne, non par le glaive du politique mais par la plume du talent. Nous sommes loin du compte.
Marc’Aureliu Pietrasanta
