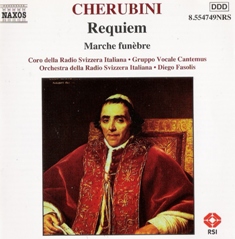 Nous voici au 2 novembre, jour consacré au souvenir des défunts. Il semble adéquat de fournir une référence musicale à cette date. Si le Requiem de Mozart nous est souvent proposé à son écoute (trop d’ailleurs, malgré sa célébrité justifiée), on omet par défaut d’attention ou volontairement- ce qui est pire- de se souvenir qu’il en est bien d’autres et des meilleurs. Pensons, même si les Requiem de Berlioz, ceux de Verdi et de Fauré connaissent des exécutions relativement fréquentes, celui par exemple de Cherubini.(1760-1842). « Engagé dans son art avec autant de force que les Romantiques, écrit Isabelle Battioni, présentatrice d’un bel album contenant cet ouvrage, il approchait son art, bien qu’appartenant par ses idéaux au XVIIe siècle, comme un artisan et non comme un prêtre » (1). Le Requiem occupe le premier disque ; le second est un CD de publicité musicale. L’œuvre a été gravée par le chœur de la Radio suisse italienne, le groupe vocal Caemus et l’Orchestre de la Radio suisse italienne. Il appartient à Diego Farolis de conduire l’Ensemble. C’est d’une bonne facture. Des chœurs homogènes et un Orchestre qui ne démérite point. Cherubini, faut il le rappeler, est l’auteur de l’opéra « Médée », véritable chef d’œuvre prenant le meilleur de Gluck et de Beethoven, considéré par Brahms comme l’apogée en son temps, de la musique dramatique. A Gluck il emprunta la sévérité du style, à Beethoven son symphonisme accentué et sa vision unitaire du drame. Le Requiem : commandité en 1815 par le gouvernement de la Restauration aspire à l’universel. C’est son compositeur qui introduisit en France le Requiem de Mozart. qu’il révérait particulièrement Pour son propre Requiem, il décida de se passer de solistes et choisit des formes synthétiques. La Marche funèbre qui précède le Requiem était destinée à la Chapelle Royale. Elle exploite une palette sonore exceptionnelle à l’image de ce gong qui surprendra plus d’un auditeur.(2)
Nous voici au 2 novembre, jour consacré au souvenir des défunts. Il semble adéquat de fournir une référence musicale à cette date. Si le Requiem de Mozart nous est souvent proposé à son écoute (trop d’ailleurs, malgré sa célébrité justifiée), on omet par défaut d’attention ou volontairement- ce qui est pire- de se souvenir qu’il en est bien d’autres et des meilleurs. Pensons, même si les Requiem de Berlioz, ceux de Verdi et de Fauré connaissent des exécutions relativement fréquentes, celui par exemple de Cherubini.(1760-1842). « Engagé dans son art avec autant de force que les Romantiques, écrit Isabelle Battioni, présentatrice d’un bel album contenant cet ouvrage, il approchait son art, bien qu’appartenant par ses idéaux au XVIIe siècle, comme un artisan et non comme un prêtre » (1). Le Requiem occupe le premier disque ; le second est un CD de publicité musicale. L’œuvre a été gravée par le chœur de la Radio suisse italienne, le groupe vocal Caemus et l’Orchestre de la Radio suisse italienne. Il appartient à Diego Farolis de conduire l’Ensemble. C’est d’une bonne facture. Des chœurs homogènes et un Orchestre qui ne démérite point. Cherubini, faut il le rappeler, est l’auteur de l’opéra « Médée », véritable chef d’œuvre prenant le meilleur de Gluck et de Beethoven, considéré par Brahms comme l’apogée en son temps, de la musique dramatique. A Gluck il emprunta la sévérité du style, à Beethoven son symphonisme accentué et sa vision unitaire du drame. Le Requiem : commandité en 1815 par le gouvernement de la Restauration aspire à l’universel. C’est son compositeur qui introduisit en France le Requiem de Mozart. qu’il révérait particulièrement Pour son propre Requiem, il décida de se passer de solistes et choisit des formes synthétiques. La Marche funèbre qui précède le Requiem était destinée à la Chapelle Royale. Elle exploite une palette sonore exceptionnelle à l’image de ce gong qui surprendra plus d’un auditeur.(2)
Vincent Azamberti
(1)Naxos 8.554749NRS
(2) Par souci de précision, on précisera que Cherubini écrivit deux Requiem. L’un en do mineur (1816), l’autre en ré mineur (1836).C’est du premier que traite cette chronique.
