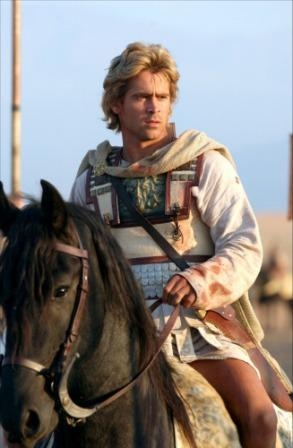 HISTOIRE ET MYTHOLOGIE Colloque international à l’Université de Corse. Importante participation d’historiens. Le mérite des organisateurs et des participants vaut la peine d’être souligné. Leur sujet : le mythe napoléonien. Si Bonaparte reste fréquentable en France, Napoléon ne l’est plus guère semble-t-il. Jusque dans son île natale, paradoxalement, à l’instar de l’Hexagone, l’empereur ne jouissait plus de la cote d’amour. Saluons donc cette audace des organisateurs de braver la pensée unique ambiante. Ils remettent ainsi à l’heure les pendules de l’Histoire. Car le rôle de l’Université n’est pas de choisir dans le passé au gré des préférences ou des fantaisies des présidents, des ministres et des gouvernants. L’Université présente aux esprits les faits. Elle laisse leur liberté aux idées. C’est bien le choix de l’Université  de Corse lorsqu’elle réunit et reçoit des historiens éminents venus des quatre points de l’horizon. Et ce thème mythologique est tout à fait à la mesure de notre temps. Il offre à nos méditations de s’informer sur une aventure humaine qui rejoint la grandeur des mythes. Celle de Napoléon dont le nom même est tiré d’Apollon. Comme si dés sa naissance, le sort, par le choix de ce prénom déjà rarissime, avait introduit la mythologie dans sa vie, en y associant l’empreinte du dieu solaire des Grecs. La mythologie n’est-elle pas l’histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux et des héros de l’Antiquité. Et voici qu’en Corse, à nouveau, le destin fit entendre un second coup annonciateur. Pascal Paoli était revenu en Corse en 1790 après vingt ans d’exil. Le jeune officier d’artillerie Bonaparte tint à passer des journées entières aux côtés du vieux patriote. Sur le chemin du village natal de celui-ci, ils s’arrêtèrent à Ponte Novu et commentèrent l’ultime bataille. Les réflexions de Napoléon impressionnèrent Paoli. Suivant son intuition il lui dit : «  Va mon fils, tu seras un homme de Plutarque.  » L’homme de la Castagniccia, à demi mazzeru, avait pressenti le héros. Le troisième homme à relever le caractère mythique de Napoléon, au sens originel du mot, fut Chateaubriand dans son dernier discours à la Chambre des pairs. Il y évoqua «  ces hommes «  fastiques  » (1) que Dieu prête à la terre tous les mille ans : Alexandre, César, Charlemagne, Napoléon.  » Oui, le sujet du mythe napoléonien a été bien choisi. Napoléon a eu pour aèdes (2), parmi les plus célèbres. Balzac admirait en Napoléon un homme prodigieux. Il a écrit : «  Ce qu’il n’a pu faire par l’épée je le ferais par la plume.  » Victor Hugo fut le raphsode (3) inspiré de l’Empereur : «  Qui mêlait sur sa tête fière/dans les rayons/L’aile de l’aigle à la crinière/ Des grands lions.  » Napoléon est devenu un des trois grands mythes historiques de la France. Il s’est joint à Jeanne d’Arc et surtout à Charlemagne dont il avait repris le sceptre mille ans après. Héros, soleil, monstre, lion, aigle, martyre. Ce sont les images du mythe. Elles sont reprises en Corse dans les chansons et les célébrations populaires. Maestrale évoque l’aiglon de la grotte du Casone :  » Trimarà , quandu parte, tutt’intornu, cume quandu scatena lu lione/ E sturzendu in le grinfie, regni e mondu/ L’aculella sarà Napuleone/. L’Ajaccienne évoque l’étoile qui guidait l’enfant prodigue de la gloire/ Sans compter ce chant vengeur :  » Il les faisait trembler encore sur le rocher de Sainte Hélène !  ». Là où Victor Hugo voyait un Prométhée cloué au pic où le vautour Angleterre lui rongeait le cÅ“ur. Comme le soleil qui disparaît la nuit, Napoléon a sa légende noire et sa légende blanche. Le colloque fera-t-il ressortir cet aspect mythique des jugements de valeur opposés selon qu’ils émanent du peuple ou du non peuple ? Quoiqu’il en soit le mythe napoléonien occupe une place considérable dans le patrimoine culturel de la Corse et de la France. Marc’Aureliu Pietrasanta 1 Fastes 2 Poètes de la Grèce ancienne 3 Chanteur qui allait de ville en ville en récitant des poèmes
HISTOIRE ET MYTHOLOGIE Colloque international à l’Université de Corse. Importante participation d’historiens. Le mérite des organisateurs et des participants vaut la peine d’être souligné. Leur sujet : le mythe napoléonien. Si Bonaparte reste fréquentable en France, Napoléon ne l’est plus guère semble-t-il. Jusque dans son île natale, paradoxalement, à l’instar de l’Hexagone, l’empereur ne jouissait plus de la cote d’amour. Saluons donc cette audace des organisateurs de braver la pensée unique ambiante. Ils remettent ainsi à l’heure les pendules de l’Histoire. Car le rôle de l’Université n’est pas de choisir dans le passé au gré des préférences ou des fantaisies des présidents, des ministres et des gouvernants. L’Université présente aux esprits les faits. Elle laisse leur liberté aux idées. C’est bien le choix de l’Université  de Corse lorsqu’elle réunit et reçoit des historiens éminents venus des quatre points de l’horizon. Et ce thème mythologique est tout à fait à la mesure de notre temps. Il offre à nos méditations de s’informer sur une aventure humaine qui rejoint la grandeur des mythes. Celle de Napoléon dont le nom même est tiré d’Apollon. Comme si dés sa naissance, le sort, par le choix de ce prénom déjà rarissime, avait introduit la mythologie dans sa vie, en y associant l’empreinte du dieu solaire des Grecs. La mythologie n’est-elle pas l’histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux et des héros de l’Antiquité. Et voici qu’en Corse, à nouveau, le destin fit entendre un second coup annonciateur. Pascal Paoli était revenu en Corse en 1790 après vingt ans d’exil. Le jeune officier d’artillerie Bonaparte tint à passer des journées entières aux côtés du vieux patriote. Sur le chemin du village natal de celui-ci, ils s’arrêtèrent à Ponte Novu et commentèrent l’ultime bataille. Les réflexions de Napoléon impressionnèrent Paoli. Suivant son intuition il lui dit : «  Va mon fils, tu seras un homme de Plutarque.  » L’homme de la Castagniccia, à demi mazzeru, avait pressenti le héros. Le troisième homme à relever le caractère mythique de Napoléon, au sens originel du mot, fut Chateaubriand dans son dernier discours à la Chambre des pairs. Il y évoqua «  ces hommes «  fastiques  » (1) que Dieu prête à la terre tous les mille ans : Alexandre, César, Charlemagne, Napoléon.  » Oui, le sujet du mythe napoléonien a été bien choisi. Napoléon a eu pour aèdes (2), parmi les plus célèbres. Balzac admirait en Napoléon un homme prodigieux. Il a écrit : «  Ce qu’il n’a pu faire par l’épée je le ferais par la plume.  » Victor Hugo fut le raphsode (3) inspiré de l’Empereur : «  Qui mêlait sur sa tête fière/dans les rayons/L’aile de l’aigle à la crinière/ Des grands lions.  » Napoléon est devenu un des trois grands mythes historiques de la France. Il s’est joint à Jeanne d’Arc et surtout à Charlemagne dont il avait repris le sceptre mille ans après. Héros, soleil, monstre, lion, aigle, martyre. Ce sont les images du mythe. Elles sont reprises en Corse dans les chansons et les célébrations populaires. Maestrale évoque l’aiglon de la grotte du Casone :  » Trimarà , quandu parte, tutt’intornu, cume quandu scatena lu lione/ E sturzendu in le grinfie, regni e mondu/ L’aculella sarà Napuleone/. L’Ajaccienne évoque l’étoile qui guidait l’enfant prodigue de la gloire/ Sans compter ce chant vengeur :  » Il les faisait trembler encore sur le rocher de Sainte Hélène !  ». Là où Victor Hugo voyait un Prométhée cloué au pic où le vautour Angleterre lui rongeait le cÅ“ur. Comme le soleil qui disparaît la nuit, Napoléon a sa légende noire et sa légende blanche. Le colloque fera-t-il ressortir cet aspect mythique des jugements de valeur opposés selon qu’ils émanent du peuple ou du non peuple ? Quoiqu’il en soit le mythe napoléonien occupe une place considérable dans le patrimoine culturel de la Corse et de la France. Marc’Aureliu Pietrasanta 1 Fastes 2 Poètes de la Grèce ancienne 3 Chanteur qui allait de ville en ville en récitant des poèmes
Accueil du site > Culture > Faits d’aujourd’hui
Faits d’aujourd’hui
mercredi 22 septembre 2010, par
