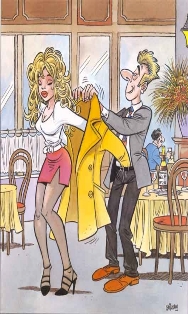 La politesse est-elle à ce point passée de mode que le retour à la barbarie sociale lui a succédé ? Le temps des cours de moral appartient vraiment au passé. Sans pour autant regretter qu’elle soit inculquée à coups de trique ou autres sévices corporels. Mais la fessée, si elle constitue aujourd’hui l’équivalent du crime de lèse-majesté, n’a jamais été autre chose qu’une forme de punition. Et la punition n’est pas non plus un mauvais traitement administré à l’encontre des têtes blondes. Mettre des interdits sociabilise. N’en déplaise aux apôtres de Dolto.
La politesse est-elle à ce point passée de mode que le retour à la barbarie sociale lui a succédé ? Le temps des cours de moral appartient vraiment au passé. Sans pour autant regretter qu’elle soit inculquée à coups de trique ou autres sévices corporels. Mais la fessée, si elle constitue aujourd’hui l’équivalent du crime de lèse-majesté, n’a jamais été autre chose qu’une forme de punition. Et la punition n’est pas non plus un mauvais traitement administré à l’encontre des têtes blondes. Mettre des interdits sociabilise. N’en déplaise aux apôtres de Dolto.
La politesse, pourquoi faire ?
La politesse est un « ensemble de comportements sociaux entre individus visant à exprimer la reconnaissance d’autrui et à être traité en tant que personne ayant des sentiments ». Elle est donc définie par des codes, un semble de règles acquises par l’éducation. Elle n’est pas innée. Elle sert à faciliter les rapports sociaux, de manière à avoir des échanges respectueux et équilibrés, permet de montrer son savoir-vivre et de faire honneur à son éducation. Certains codes ont changé, d’autres sont devenus désuets. La base reste de dire « bonjour », « au revoir », « s’il vous plaît », « merci », sans oublier de sourires à son interlocuteur, ni de s’habiller de manière convenable selon les circonstances (certains touristes qui franchissent les seuils des églises et chapelles en tenue de plage en plein office semblent l’avoir oublié…). En d’autres termes, et au risque de paraître rétrograde, la politesse est une façon élémentaire de témoigner le respect.
Politesse contre barbarie
À voir les manières pratiquées à travers les médias, où couper la parole est devenu un art, force est de constater que les lacunes sont grandes. Et l’on peut sérieusement se demander si elle fait encore partie des usages en pratique tant la saison touristique montre des travers en la matière. Si les touristes ont parfois le don d’être exaspérants à s’émerveiller de tout, à prendre la Corse pour un écomusée, à se moquer des coutumes locales ou autres comportements si connotés, les insulaires ne sont pas en reste pour montrer le côté « sauvage » de l’île. Se moquer ouvertement des gens en Corse n’est pas une règle d’hospitalité… Profiter de la crédulité des touristes non plus. La « macagna », si elle est un sport régional sans ambiguïté, n’est pas vécue comme une courtoisie par les non initiés… Autrement dit, la politesse en tant que forme de respect élémentaire fonctionne très bien dans l’échange. Et même s’il existe des particularismes régionaux, il y a des formes élémentaires qui ont valeur universelle et permettent de cohabiter en bonne intelligence.
Un code pas si désuet
La politesse n’est pas un sujet d’écriture et de compilation de bonnes pratiques, son enseignement est inscrit dans le sens commun. Au-delà de la théorie, c’est dans la pratique qu’elle prend son sens. Et c’est dès l’enfance qu’il faut inculquer la politesse. Elle sert à aider l’enfant à lutter contre le principe de plaisir. Car être poli, c’est savoir que l’autre existe, savoir qu’il peut ressentir et souffrir. Tenir compte de ce principe élémentaire permet de fixer des limites, et le cas échéant, lorsque ces limites sont transgressées, de punir. Le respect de l’autre passe tant par les actes, que par les paroles. Et si l’école est un laboratoire d’instruction et de comportement social, c’est en premier lieu aux parents d’apprendre la politesse à leur enfant, en lui inculquant le fondamental : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse ».
Maria Mariana
